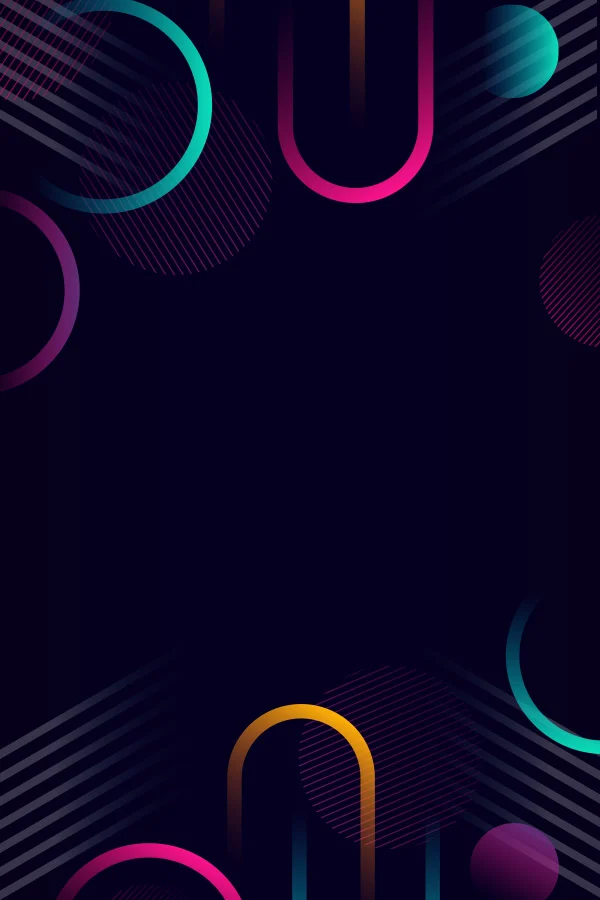Jean-François Cerisier, Université de Poitiers
Lors de sa conférence de presse du 16 janvier 2024, le président de la République Emmanuel Macron dénonçait les dangers de la surexposition des jeunes enfants aux « écrans qui, trop souvent, enferment là où ils devraient libérer ».
Il annonçait la création d’un groupe d’experts dont les analyses et les propositions sont attendues fin mars. Objectif : prendre des mesures pour réguler les pratiques numériques juvéniles « à la maison comme en classe, parce qu’il en va de l’avenir de nos sociétés et de nos démocraties ».
Si ces préoccupations sont partagées depuis longtemps par tous les acteurs de l’éducation, le vocabulaire employé par le chef de l’État, son constat de situation, le comité qu’il a mis en place et les pistes d’action qu’il a évoquées méritent un décryptage.
Dépasser la polarisation des opinions
Il est évident depuis plusieurs dizaines d’années que les techniques numériques transforment la plupart des activités humaines. Pourtant, beaucoup semblent découvrir que ce mouvement affecte tout autant nos comportements, croyances, valeurs, coutumes et imaginaires.
Fortement empreints d’une idéologie qui subordonne le progrès social à une croissance économique dépendante de l’innovation technique, les discours en faveur du numérique ont longtemps balayé analyses critiques, réserves et craintes. Il en va autrement aujourd’hui, alors que 67 % des enfants de 8 à 10 ans disposent déjà de comptes sur un ou plusieurs réseaux sociaux, que 20 % d’entre eux déclarent avoir été confrontés à une situation de cyberharcèlement et que 83 % des parents reconnaissent ne pas savoir ce que leurs enfants font sur Internet.
Toute une jeunesse se transforme sous nos yeux. On peut affirmer sans exagérer qu’une véritable panique morale s’empare du discours des élites et sature l’espace public. Elle invisibilise nombre de pratiques, d’analyses, d’arguments, de points de vue et confisque la parole de certains acteurs. Celle des plus jeunes en particulier. Certaines de leurs pratiques numériques nourrissent légitimement les craintes des adultes alors que d’autres présentent un intérêt culturel, éducatif ou social indéniable.
Cette radicalisation des postures laisse malheureusement peu de place au débat et à la controverse. Pourtant, la recherche scientifique, dans sa diversité et sa pluridisciplinarité, attire l’attention sur la complexité d’un tableau tout en nuances où l’usage du numérique se révèle autant émancipateur qu’aliénant. Dans ce contexte, l’enjeu n’est pas seulement d’échapper aux risques du numérique mais aussi de pouvoir en réaliser les promesses.
« Danger des écrans » : une formulation inadaptée
À la fin des années 90, évoquant la télévision et les jeux vidéo, Monique Brachet-Lehur interpellait déjà les parents dans un ouvrage au titre provocateur : Les écrans dévorent-ils vos enfants ?. Les risques d’addiction, de désocialisation, de sédentarisation, d’exposition à la violence et à la pornographie étaient alors opposés aux arguments enthousiastes de ceux pour qui la télévision était potentiellement l’instrument d’une démocratisation du savoir et d’un nouveau rapport au monde. Une « école parallèle » comme le théorisaient Georges Friedmann et Louis Porcher.
À l’époque déjà, la référence insistante aux « écrans » divisait car cette essentialisation masque les autres dimensions des pratiques télévisuelles d’hier et numériques d’aujourd’hui. Pierre Chambat et Alain Ehrenberg déconstruisaient d’ailleurs en 1988 la « supposée fascination des écrans ». Ils montraient combien ce stéréotype se nourrit d’une confusion entre l’écran (le support), l’image (le contenu) et le spectacle (la pratique). Si fascination il y a, et si l’écran y joue un rôle, c’est bien l’activité qu’il contribue à instrumenter qui doit être interrogée.
Incriminer les écrans équivaut en quelque sorte à redouter la nocivité du papier ou celle de la langue quand c’est le texte et l’usage qui en est fait qui méritent d’être questionnés. On peut bien sûr attribuer aux écrans certains risques sanitaires, indépendamment des contenus qu’ils médiatisent, mais convenons que l’essentiel est ailleurs !
Temporalité des activités numériques : durées, instants et fréquences
Différentes études considèrent le temps d’utilisation des équipements comme principal indicateur des pratiques numériques. Nous sommes d’ailleurs tous invités à prendre connaissance de cette métrique de nos activités numériques lorsque nos smartphones notifient nos « temps d’écran ».
En dépit des limites déjà énoncées de cette synecdoque qui confond l’écran (la partie) avec la pratique numérique (le tout), la temporalité des usages constitue l’un des éléments descriptifs des pratiques numériques et des risques potentiellement associés. Pour lui donner du sens, il convient de ne pas se limiter à des valeurs moyennes de durées.
Ainsi l’étude pluridisciplinaire ELFE (Étude longitudinale française depuis l’enfance) qui porte sur une cohorte d’environ 18000 enfants français nés en 2011 montre que le « temps d’écran » quotidien moyen des enfants de 5 ans et demi, tous types d’écrans confondus, était d’environ 1h30 en 2017 et qu’il dépassait 4h pour près de 5 % d’entre eux. Une autre enquête, réalisée par Ipsos en 2022 indique un temps moyen d’écran quotidien de 3h30 pour les enfants de 7 ans à 12 ans à douze ans et de plus de 5 heures pour les 13-19 ans.
Ces valeurs nous impressionnent. Pour autant, la durée quotidienne d’utilisation d’un smartphone dit intrinsèquement peu des dangers encourus. La temporalité des activités numériques se caractérise aussi par un positionnement temporel précis (horodatage) et une fréquence (nombre d’utilisations par unité de temps). Ainsi, durées, instants et fréquences ont-ils des implications spécifiques et des effets combinés.
Si l’allongement des durées moyennes d’utilisation, les horaires inappropriés (durant la nuit, les repas, le temps scolaire…) et les fréquences élevées inquiètent, c’est en raison des activités dont elles témoignent mais aussi de celles qu’elles sont susceptibles de remplacer : se distraire au lieu d’étudier, veiller au lieu de dormir, s’engager dans des activités individuelles au lieu de s’investir dans des pratiques sociales… La question du temps est donc tout autant qualitative que quantitative.
Usages et mésusages
Les mésusages numériques sont assez bien connus, décrits et analysés. Il est possible de dresser un inventaire, sans doute incomplet et discutable, mais éloquent des dangers qu’ils induisent : manipulation, harcèlement, radicalisation, dépendance, déréalisation, exposition de la vie privée, troubles de l’identité, troubles du sommeil, déficits attentionnels, dégradation de l’estime de soi, réduction de l’empathie, altération de la perception de la violence, troubles du comportement, stress, altération de la perception du corps, difficultés de construction des relations amoureuses ou sexuelles…
Longue liste, très hétérogène, dont l’étendue et la profondeur croissent à l’aune de la prégnance du numérique dans notre société. Comme le souligne justement le président de la République, il est urgent de s’en occuper sérieusement. Pour autant, il est tout aussi essentiel de prendre connaissance des pratiques numériques effectives des jeunes et d’en reconnaître la valeur et les vertus. Favoriser les pratiques vertueuses (qui ne sont pas celles des adultes ou celles dont ils rêvent pour leurs enfants) est tout aussi important.
De nombreux travaux de recherche documentent et analysent les pratiques des jeunes. Notons ceux d’Anne Cordier ou de Carine Aillerie sur les pratiques informationnelles ; ceux de Dominique Pasquier, Pascal Plantard, ou de Sophie Jehel sur la sociabilité des adolescents et l’apport des réseaux sociaux à leur construction identitaire ; ceux aussi de Sylvie Octobre sur le renouvellement des pratiques culturelles. Entre bien d’autres !
Notons que la plupart de ces recherches partagent une approche compréhensive et qu’elles ne projettent pas systématiquement les normes et les valeurs des adultes sur les pratiques des jeunes.
Régulation, autorégulation, ce que (ne) peut (pas) l’État
Comment contribuer à diminuer les risques et maximiser les opportunités ? Les « leviers » disponibles sont bien connus mais pas toujours aisés à actionner. Il y a d’abord tout le volet légal avec des dispositions nationales qui s’inscrivent souvent dans des démarches européennes.
Même si l’espace européen est bien plus protecteur que la plupart des autres régions du monde, on observe combien le lobbying joue efficacement contre la régulation. Rappelons ici l’exemple du cheminement décevant de la loi Studer, votée le 2 mars 2022, sur l’installation obligatoire et l’activation automatique d’un système de contrôle parental sur les équipements numériques des mineurs. Loi dont les décrets d’application sont venus amoindrir la portée du projet initial, pourtant salué de toutes parts.
Ainsi, comme le soulignent plusieurs avis de la CNIL, l’inscription de ce contrôle parental au Code des postes et communications électroniques est imprécise et peu exigeante : le contrôle du temps d’utilisation et de la vérification d’âge n’est pas obligatoire, les obligations concernant le filtrage de la navigation Internet sont minimales et conditionnées par leur faisabilité technique.
L’autre levier est constitué de tout ce qui peut favoriser l’autorégulation des usages, autrement dit l’éducation au numérique, aux médias et à l’information, en lien avec une éducation au comportement éthique et responsable. Cela suppose de penser plus largement les places et rôles respectifs des parents et de l’école.
Cela suppose des dispositifs et ressources d’accompagnement à l’e-parentalité. Cela suppose également une institutionnalisation plus importante et plus exigeante de l’éducation au numérique et à l’information, donnant encore plus d’ampleur au travail engagé depuis longtemps par des services de l’État comme le CLEMI. Tout ceci suppose enfin une démarche collégiale et un débat citoyen pour construire un véritable projet éducatif équilibré.
Pour ce faire, le principe de la constitution du groupe d’experts annoncée le 16 janvier est positif. Cependant, il est regrettable que la présence de la recherche soit aussi faible et que les jeunes, les familles et les associations dont l’expérience de terrain est si précieuse n’y participent pas.
Jean-François Cerisier, Professeur de sciences de l’information et de la communication, Université de Poitiers
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
À découvrir sur le même sujet, »Notre rapport aux écrans dans un monde numérique avec Vanessa Lalo psychologue«